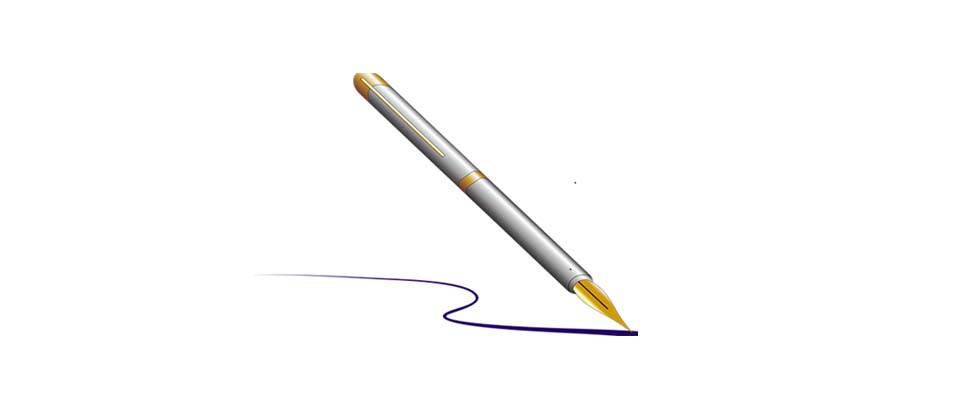Pourquoi est-il si difficile de changer ? Les fétichistes des acquis redoutent l’instabilité et se focalisent sur la stabilité, quitte à passer pour des conservateurs, que faut-il en penser ?
À lire les parcours de vie de bon nombre de nos contemporains, je constate d’incroyables réorientations eu égard à leur formation de départ. Des rencontres, des voyages, des expériences heureuses ou malheureuses, des convictions, interviennent sans prévenir et contribuent à vous faire changer de cap. Bien sûr, le système éducatif rêve de filières qui forment à un métier, métier qu’on occupera toute sa vie « active ». C’est une illusion, car les emplois à venir ne sont pas encore connus et répertoriés, songeons aux activités liées à l’environnement ou au numérique… Enfant, je trouvais stupide la sempiternelle question à la fin des repas de famille : « Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » Ce « plus tard » m’effrayait. D’autant que je n’avais de réponse ! Étais-je un déviant ? L’ordre social a peur des tourbillons de l’existence, il récompense l’obstination au détriment de l’audace.
Être conforme au moule correspond à une vie sans turbulences, monotone, garantie, jusqu’à la retraite, qui sonne comme une défaite ! Avec les modifications profondes qui métamorphosent le travail (précariat, stagériat, intérim, télétravail, robotisation…), la société acquiert de la souplesse et l’on parle de formation tout au long de la vie, c’est donc un appel au changement… imposé par le système ! Je préfère, bien évidemment, choisir moi-même ma voie.
Professionnellement, le changement est devenu une sommation, malheur à celui qui ne change pas, comment l’expliquer ?
La première étape du capitalisme industriel disciplinait le travail, il fallait transformer un paysan aux horaires variables et saisonniers en un travailleur obéissant à l’horloge-pointeuse. En échange, celui-ci occupait à vie son poste et recevait, pour sa fidélité, une montre aux armes de l’usine ! Le capitalisme financiarisé, dorénavant globalisé, recherche l’efficacité qui git dans la variété, aussi encourage-t-il ce qu’il nomme « l’innovation ». Celle-ci s’apparente à un nouveau conformisme, car les véritables « avancées », tant technologiques que médicales, par exemple, ne sont pas réglées sur les modes et autres effets de renouvellement. Dorénavant, le bien-être s’invite, il dénonce le burn-out, le harcèlement moral et sexuel, le plan de carrière et réclame des horaires à la carte, des pratiques collaboratives, des tiers-lieux…
Les utopies évoquent-elles cette situation ambivalente : l’harmonie d’une continuité et le plaisir de la variété ? Traitent-elles des services publics ?
Depuis Thomas More, les utopies limitent le temps de travail, lui-même suggérait 6h par jour, mais il ne faudrait pas croire qu’elles exaltaient la paresse et rêvaient d’une société d’abondance… Fourier, par exemple, fait du travail l’activité principale, il regrette même de ne pouvoir réduire le temps de sommeil ! La grande différence avec notre société réside dans le fait que dans le Phalanstère le travail est attractif, chacune et chacun changent d’activité toutes les heures, ainsi l’ennui disparaît, et découvrent de nouvelles expériences qui les enrichissent. Le travail se fait alors plaisir ! La plupart des utopies réduisent au maximum les « services publics », elles misent sur la déconcentration et la décentralisation de ces fonctions certes indispensables mais partagées.
Stéphane Menu
(1) Thierry Paquot, philosophe, vient de publier Lettres à Thomas More sur son utopie (et celles qui nous manquent), La Découverte, 2016 et Dicorue. Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, avec des photographies de Frédéric Soltan, CNRS-éditions, 2017.